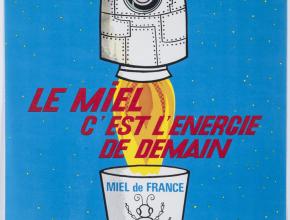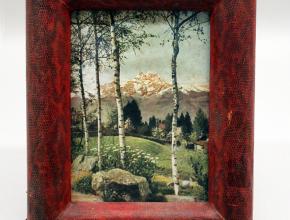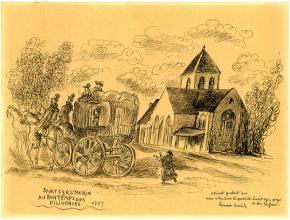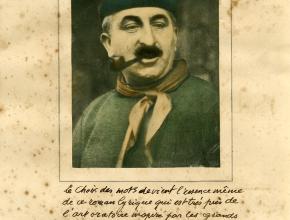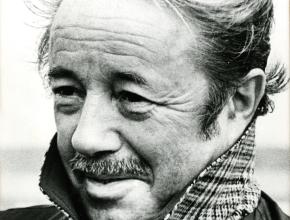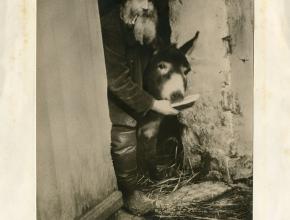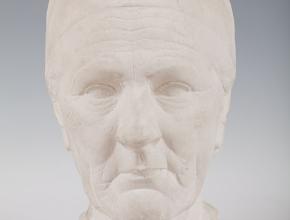Flash info

À noter : Le musée est fermé pour la période hivernale du 01/12/2025 au 28/02/2026 inclus.
Pendant cette période, nous continuerons d'accueillir les groupes sur réservation, nous contacter par téléphone. Le musée rouvrira ses portes le dimanche 1er mars 2026 aux horaires habituels.