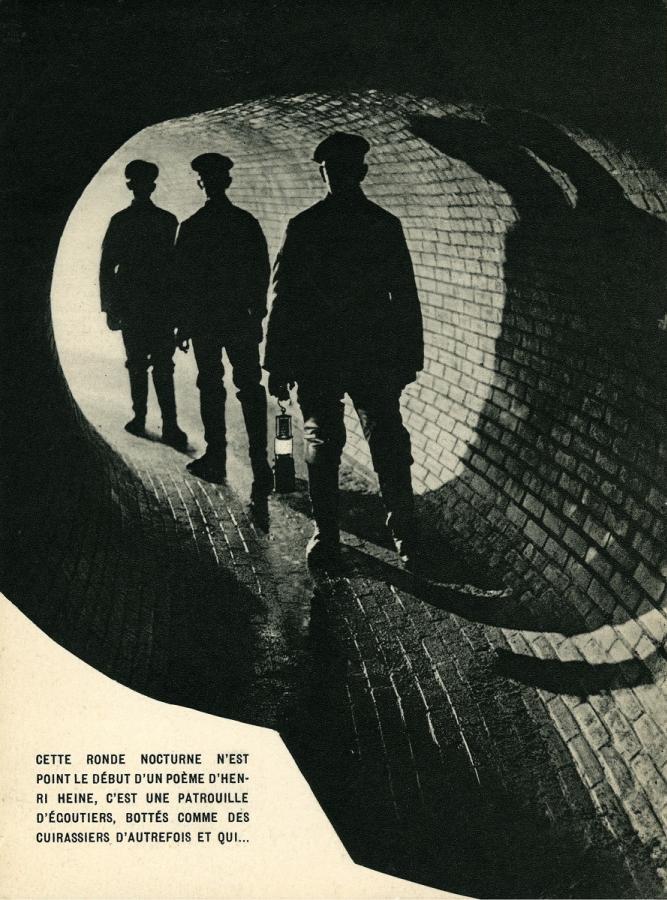Le siècle pendant lequel Pierre Mac Orlan construit son œuvre est, plus qu'un autre, dominé par une inconcevable puissance de mort - parce que le progrès industriel autorise, justement, une quantité de souffrance nouvelle, inconnue
jusque-là dans l'histoire des hommes.
L'Utopie - sociale ou raciale - domine le siècle et, selon le jeu implacable des causes et des effets, des influences idéologiques et des emprunts tactiques, elle va faire de l'Europe l'endroit infernal des charniers et des décombres.
De cette révolution européenne, Pierre Mac Orlan est donc le contemporain inquiet. Et il le dit, dans ses ouvrages sur la guerre 1914-18, dans ses ouvrages inspirés par la Révolution russe : La cavalière Elsa, La Vénus internationale…
Son prophétisme catastrophique a collé au siècle, par le hasard d'une enfance sans famille, d'une jeunesse misérable et d'une guerre atroce.
La Grande Guerre a profondément marqué Pierre Mac Orlan, qui s'en souviendra toujours, ici et là, dans ses œuvres. Il en tira une gloire très discrète, en dépit de l'assez grand nombre de livres que l'expérience directe du cataclysme lui inspira.
"Dans les tranchées, c'est la peur et l'hébétude qui se partagent les corps et les âmes dans l'odeur du sang et de la mort. Misère totale, indépassable, et qui n'est dérangée que par l'assaut, qui est une loterie hagarde. Le progrès incessant de la puissance de feu et la physique mystérieuse qui régit les rencontres des corps et des projectiles dans l'espace stratégique, sont les deux divinités qui trient les bons numéros des mauvais."
Pierre Dumarchey se bat à Morhange dans le 20ème Corps d'Armée, puis, lors de l'offensive d'Artois, à Neuville, Carency, Souchez, le Cabaret Rouge... Combats très durs, sur un front de 7 km, pour réduire le saillant entre Carency, Lorette, La Targette, Souchez. Le 1er juillet 1916, commence l'offensive de la Somme. Puis c'est la "route de Bapaume", et la "chance de la bonne blessure", blessure incapacitante mais non mutilante. Décoré de la Croix de Guerre avec citation qui fait mention de "missions très dangereuses" et de "grand courage", le soldat de 1ère classe Pierre Dumarchey est réformé le 8 décembre 1917.
La leçon que Mac Orlan tire de la guerre est ample et nuancée. Elle conforte, par l'expérience de la vie en commun et des périls partagés, cette grande affection qu'il montra toujours pour tous les soldats du monde, auxquels il donna la préséance morale et esthétique, dans la marche de l'Histoire, sur les ingénieurs dont ils ne sont que les cobayes glorieux.
Pour Mac Orlan, c'est l'aventure, non la préoccupation politique d'un gouvernement ou d'un état-major, qui fonde la justification mystérieuse de l'homme d'armes. C'est d'ailleurs pourquoi la Légion - qui mêle les nations dans ses rangs - trouve dans la conscience du poète un écho sentimental particulier : il la connaît bien et aime la dépeindre comme "un bloc de métal pur, sans une paille", une "force poétique" parce qu'elle n'a aucune patrie à servir - qu'elle-même.
"Un match d'un homme de soixante-dix kilos contre un obus de même poids est, sans discussion, une des inventions les plus sottes de notre temps. Toute la guerre de 1914 est établie sur ces proportions." (Petit manuel du parfait aventurier, 1920)
"On se demande par quelle aberration les hommes ont pu admettre qu'ils pouvaient garder des chances de succès en luttant contre un obus de 420 et toutes les promesses d'un avenir qui semble fécond." (Sous la croix blanche)
" On peut être, à la rigueur, fier d'un coup d'épée, on ne peut s'enorgueillir d'avoir été aplati comme une punaise." (Verdun, 1935)
Bref, la guerre moderne est une "monstrueuse divinité" et les grandes inventions "ne servent, en définitive, qu'à la perfection dans le meurtre." (Masques sur mesure, 1937 et 1965).
Et La petite cloche de Sorbonne (1959) sonnera le même tocsin allant jusqu'à confondre "l'apothéose de la cruauté scientifique" avec la "pestilence tenace du progrès humain".
Quelques chiffres en donneront une idée. La grosse pièce qui était située à Chuignes, près de Bray-sur-Somme, était une pièce de marine de 380.
Le nom de "Grosse Bertha" (Dicke Bertha) est donné par les Allemands, en hommage à Mme Krupp dont c'est le prénom, à une pièce de 420 qui tire des obus d'un quintal et a une portée de 10 km environ.
En 1914, dans la région de Coucy-le-Château, les Allemands utilisent une pièce de marine de 380, dont les obus pèsent 750 kg. Portée : de 35 à 40 km. Le tube mesure 17 m. En 1917, la portée du 380 atteint 62 km.
Les Français ne sont pas en reste, qui utilisent des obusiers de 520 tirant des projectiles de 1,6 tonne.
Mais on n'arrête pas le progrès : le 23 mars 1918, un nouveau canon allemand entre en action contre Paris. La pièce est située près de Crépy-en-Laonnois et porte à 120 km. Calibre 210, 34m de tube. Pour les Allemands, c'est le fameux "Pariser Canonen" – le "Paris Gun" des historiographes anglo-saxons -, dont on change le tube tous les 65 coups et qui se déplace sur rails. Le 29 mars 1918, un obus tombe sur l'église Saint-Gervais pendant l'office : le bilan est de 75 morts et 90 blessés…
Depuis, on a fait mieux : le 6 avril 1945, à Hiroshima, une seule bombe fera 140 000 morts. En 1946, Georges Grosz peint La Fosse, après la mort de sa mère sous une autre bombe américaine. Grosz y rend hommage au progrès en renouvelant les visions de Bosch et en actualisant Le triomphe de la mort de Bruegel : guerre, mort, chaos, enfer.
La Grande Guerre a lancé sur l'Europe sa durable malédiction technicienne qui donne au soldat sa puissance de mort accrue :"On tuait tout", écrit brutalement Mac Orlan dans son Bataillon de la mauvaise chance (1937), où son pessimisme devant le progrès se nourrit d'images insoutenables, de choses vues comme à travers les fissures d'un enfer réaliste : sur la route de Cléry, éclairée par un soleil lugubre d'automne, un vieux soldat marche avec d'étranges précautions : il tient à pleines mains "ses entrailles pour les empêcher de tomber par l'ouverture béante d'une blessure inimaginable."
Les "grands cataclysmes de la nature" que sont les révolutions constituent comme "un résultat collectif des espoirs pervers de l'humanité".
Le mythe de la Cité idéale peut enfin recourir, pour s'incarner, à des moyens plus subtils, dus aux plus récents développements de la science psychologique. Les réfractaires seront alors traités comme le chien de Pavlov et normalisés de l'intérieur. Les prisons et les camps seront baptisés du beau nom d'asiles - et le nouveau démiurge ne sera plus chirurgien mais psychiatre - tel le Mujina de La clique du Café Brebis, esprit médiocre et confus, néanmoins directeur "d'un Institut de rééducation intellectuelle".